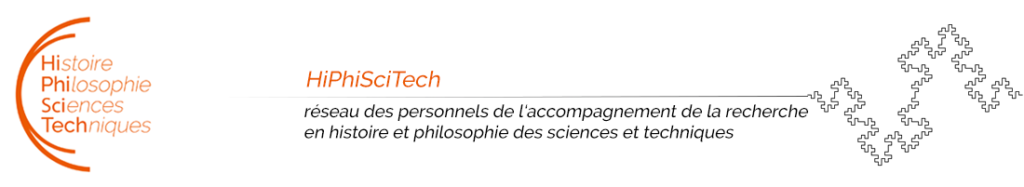|
Différent de l'auto-archivage réalisé par les auteurs, un dépôt sur ces plateformes fait l'objet d'une validation par une commission en relation avec l'établissement de soutenance et est pris en charge par une instance mandatée (Service Commun de la Documentation ; Direction de l'Appui à la Recherche ; Bibliothèque ; ...). |
DUMAS
-> Lien vers DUMASPlateforme de "Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance" Derniers mémoires recensés
À la fin du XIXe siècle, les conceptions philosophiques classiques des sciences physiques ont été bouleversées par certaines avancées scientifiques. En effet, juste avant le renouveau de la physique induit par les deux théories de la relativité d'Einstein, l'essor des géométries non-euclidiennes et la théorisation de l'imprévisibilité de certains systèmes dynamiques déterministes ont donné lieu à des débats philosophiques houleux : que faire de l'a priori kantien et du libre arbitre après ces découvertes ? Ces débats philosophiques basés sur des questions scientifiques sont principalement développés dans des articles de revues, qui se répondent mutuellement. Pour étudier ce corpus, il a fallu identifier les discussions, les structurer et les situer.
Après avoir été effrayé à l’idée de voyager par plaisir en raison de la connotation guerrière de cette dernière mais également d’une peur des reliefs naturels, une nouvelle perception renverse à la fin du XVIe siècle cette pensée. La conception utilitaire du voyage prend l'ascendant au cours du siècle suivant, avec la possibilité d'apprendre et de se forger une culture personnelle jugée essentielle aux nobles de cette époque. Cette conception évolue à nouveau grâce à l'influence des Lumières et de nombreuses découvertes scientifiques ou philosophiques du XVIIIe siècle. La pratique voyageuse est maintenant comprise comme un moyen de connaître la terre, de partager les savoirs pour une plus grande égalité. Dans ce contexte, les scientifiques sont devenues des acteurs centraux, notamment en se rendant directement sur les lieux à expertiser. Ainsi, en plus d'une large publication d'imprimés de relation de voyage fait par des nobles en mission diplomatique ou dans la réalisation de leurs Grands Tours, se développent en parallèle des mémoires scientifiques tirés de leurs voyages. Dans la même période, un nouvel acteur dans le chaînon de l'imprimerie vient bouleverser l'ordre établi au siècle précédent, les périodiques. C'est avec ce nouveau support que les savants-voyageurs ont diffusé non seulement des extraits de leurs mémoires mais également des lettres, des synthèses et des questionnements portants sur les avancées scientifiques. Dans ce microcosme où vivent savants et acteurs de l'impression, de nombreux d’échanges et interactions s’étiolent, tels que des demandes d'instructions spécifiques ou d'aide particulière pour récupérer divers échantillons provenant d'une région lointaine. Cet ensemble se représente également à travers le carnet, un outil essentiel à la sauvegarde des pensées du voyageur qui le suit en toutes circonstances au cours de ses trajets. C'est avec cette source que ce mémoire se propose de retracer la méthodologie d'un savant-voyageur au tournant du XVIIIe siècle en la personne du chevalier Déodat de Dolomieu. Au travers de ses carnets se dévoile les traces de sa pensée savante et des évolutions de cette dernière au cours de ses pérégrinations, permettant la reconstruction d'une méthodologie propre à ce dernier. De même, elle permet la sauvegarde des humeurs de son propriétaire au cours de ses trajets mettant en lumière sa perception de la pratique voyageuse. Enfin, ce même objet se révèle être l'outil le plus essentiel à la propre compréhension de sa conception aux yeux de son propriétaire, ainsi que de pouvoir distinguer si cela est réellement nécessaire les propriétés entre une relation de voyages pour son plaisir et celui d'une relation savante faite pour autrui.
Notre projet de mémoire, ci-dessous développé, est le suivant : comment étudier la notion d'émergence dans le cadre de la métaphysique anglo-saxonne contemporaine ? Pour répondre à cette question, notre réflexion partira du système ontologique particulier, à savoir le "carré ontologique", d'inspiration aristotélicienne et repris par un auteur contemporain, E.J. Lowe. Dans ce système, les catégories ontologique d'"objet", de "phénomène", de "propriété" et de "condition" sont analysées comme étant fondamentales, irréductibles et suffisantes pour décrire tout le contenu de la réalité. Nous nous sommes limités cette année à la présentation de ce système, espérant par la suite pouvoir le développer dans le sens d'un physicalisme non réductif. Notre thèse finale sera alors la suivante : il est possible que de nouvelles conditions émergent.
Nous proposons à travers ce travail de regarder la pensée philosophique comme étant essentiellement liée au phénomène d'ἀνάμνησις, c'est-à-dire au ressouvenir ou à l'anamnèse. Nous cherchons à repenser le propre du philosopher. Dans cette optique, philosopher signifie "se ressouvenir". Pourtant, l'anamnèse n'a pas affaire à la mémoire et aux souvenirs. Elle est expérience, à travers laquelle adviennent une vérité et un savoir. Notre point de départ se trouve dans une évidence de la pensée philosophique : la pensée a une histoire et s'enracine dans une tradition. Tout ce qu'on met devant la pensée, tout ce que la pensée prend comme tâche a un lien avec ce qui a été pensé auparavant ou fait référence à ce qui a été, qu'on l'admette ou non. Nous identifions, cachée sous la forme de cette évidence, une tendance de la pensée philosophique qui n'a pas été mise en question ou explicitée. Ainsi, philosopher c'est dans un certain sens se retourner vers le passé afin de le reprendre sous un jour nouveau. Ce point de départ trouve sa confirmation philosophique à travers une analyse "historique" : l'anamnèse chez Platon et Gadamer. C'est à travers cette façon de mettre à l'œuvre ce que l'évidence nous a dévoilé qu'on découvre que l'anamnèse décrit la recherche et la découverte de type philosophique. Pour Platon, l'άνάμνησις représente moins une actualisation d'un savoir tout fait, inné et latent, qu'une manière de reprendre quelque chose de "su" sous un jour nouveau. C'est donc ce mouvement "rétrospectif" qui rend possible le savoir et la vérité pour la pensée philosophique. Selon Gadamer, l'άνάμνησις platonicienne s'apparente à une re-connaissance. Ces deux analyses dévoilent une certaine "structure" que possède l'anamnèse, un certain mode d'être : elle se définit par le "re-". Il s'agit d'un re-vivre, re-connaître, re-conquérir, re-voir "à distance" la réalité. Ceci renvoie à l'idée de "voir" les choses "dans une autre lumière", ou faire une nouvelle expérience des choses qui apporterait un surcroit de connaissance. Le "re-" de l'anamnèse désigne le fait de re-faire une "expérience". L'anamnèse représente une expérience du philosopher. Philosopher et parvenir à un savoir signifie, dans ce sens, faire l'expérience de l'expérience.
Cette étude tente de répondre à la question "qu'est-ce que le jazz ?" en partant des spécificités musicologiques propres à cette musique pour rejoindre la pensée sociale et culturelle du jazz. Plus qu'un simple travail de définition, il s'agit d'analyser le jazz pour en extraire ses valeurs, d'interpréter les phénomènes musicaux jazzistiques en les plaçant toujours déjà dans un contexte historique et social déterminé. Penser le jazz, c'est établir son unité esthétique. Pourtant, on n'épuise pas le phénomène jazzistique à parler de swing et de sonorité : penser le jazz c'est aussi comprendre les origines musicales d'une telle musique et donc utiliser une méthode généalogique permettant de comprendre pourquoi, un jour, des hommes ont joué de la musique de telle manière. Le discours musicologique s'ouvre à la philosophie sociale et aux sciences historiques. Penser le jazz, c'est alors comprendre qu'il est une musique populaire, issu de la rencontre brutale des musique occidentale et africaine dans le contexte de la ségrégation raciale. Si certains discours sur la musique font de l'abstraction leur crédo, un discours sur le jazz semble devoir nécessairement prendre en compte les contextes socio-historiques dans lesquelles on joue du jazz. Le jazz se joue, se danse, s'incarne dans des gestes, des attitudes et des corps, et ce faisant, véhicule une pensée musicale que l'on ne peut pas comprendre si l'on s'en tient à une analyse musicologique. Penser le jazz comme pensée, ériger le jazz en porte d'entrée privilégiée d'une culture américaine naissante, comprendre l'encrage de la musique de jazz dans la Weltanschauung américaine sont les enjeux de cette étude qui donne en outre des pistes tant méthodologiques que généalogiques pour entreprendre une analyse des musiques populaires postérieures au jazz.
Ce mémoire s'intéresse aux collaborations possibles entre Intelligence Artificielle et philosophie. Il montre que les deux disciplines peuvent partager des objets, des théories et des résultats pour apprendre l'une de l'autre. La stratégie de ce mémoire consiste à expliciter des relations épistémologiques entre les problématiques propres aux deux disciplines ("IA faible" et "IA forte"), afin de définir des modes de collaboration sur le plan disciplinaire. La deuxième partie de ce mémoire présente les travaux de philosophes et de spécialistes de l'IA, depuis les débuts de l'Intelligence Artificielle jusqu'aux années 80. Elle expose les démarches collaboratives exploitées par ces chercheurs, de manière implicite ou explicite. La troisième partie présente des travaux où la philosophie sert de socle conceptuel à l'Intelligence Artificielle, notamment en ce qui concerne la simulation de phénomènes émergents. La quatrième partie réalise un renversement des relations classiques entre les deux disciplines. C'est au tour de l'Intelligence Artificielle de se mettre au service de la philosophie, en formulant de nouvelles hypothèses de recherche ou en testant les théories philosophiques à partir de cas concrets. Ce mémoire, enfin, espère œuvrer pour le rapprochement des deux disciplines et ainsi encourager philosophes et spécialistes de l'IA à collaborer sur les sujets qui leurs sont chers.
Les derniers écrits (1946-51) de Wittgenstein s'occupent principalement de philosophie de la psychologie et s'attaquent à certaines théories classiques de l'esprit, que les commentateurs qualifient de mythologies. Notre travail consiste à évaluer la possibilité de la présence de ces mythologies de l'esprit à l'intérieur des théories construites par les sciences psychologiques ainsi que les implications sur la psychologie que cette présence est susceptible d'avoir. En nous appuyant sur certains des points centraux de la critique wittgensteinienne (l'usage ordinaire, la distinction conceptuel / empirique, etc.), nous montrons qu'il est envisageable de dégager des thèses, d'inspiration wittgensteinienne, délimitant les prétentions de la psychologie. L'œuvre de Wittgenstein fournirait donc un outil, dans une mesure que nous nous efforçons d'apprécier, pour une mise en débat de la scientificité de la psychologie, en particulier des neurosciences cognitives.
S'interroger sur le clonage, c'est s'interroger sur ce qu'il produit, à savoir le clone, le double, dont il s'agira pour nous d'appréhender le sens et de voir en quoi cet être recréé, reproduit par clonage présente une figure complexe, en quoi il représente un être particulier, au statut quelque peu singulier. Il importe donc de définir ce que signifie, ontologiquement et symboliquement, l'action même de cloner et de définir ainsi ce que signifie l'existence d'un clone. En effet, la question du clonage ne peut être séparée de la question même du clone puisque sans clone, il n'y aurait pas lieu de parler de clonage. Par ailleurs, il nous faut définir ce qu'est scientifiquement le clonage. Nous montrerons alors que les définitions mènent parfois à des quiproquos et des illusions qui n'ont pas lieu d'être une fois le terme clairement défini.
|
TEL
-> Lien vers TELServeur de "Thèses en Ligne" et HDR Dernières thèses ou HDR recensées
In quantum mechanics, quantum nonseparability is at the core of philosophical debates regarding its meaning. In the context of the process matrix formalism, causal nonseparability characterises quantum processes (connecting the inputs and outputs of different local quantum operations) that are incompatible with any definite causal structure among interacting parties. One talks about indefinite causal orders. A famous example of causally nonseparable processes is called the quantum switch (QS). It is extensively studied in the literature in virtue of its simple architecture and its various implementations in laboratories.The present work will discuss the possible interpretations of the QS's causal nonseparability under the assumption that causal nonseparability is seen as pointing towards novel objective features of nature.It was first defended that a scientific realist approach towards the process matrix formalism, which is an operational theory generalising quantum mechanics, was as much legitimate as any possible antirealist reading, contrary to certain views found in the literature. The reason is that operational formalisms are ontologically and epistemically neutral.From there, the theoretical concepts of interest, namely causal nonseparability and its model-independent counterpart called noncausality, were analysed in more details, in order to highlight in what sense they are distinct from the standard notions of quantum nonseparability and nonlocality in quantum mechanics.The discussion then focused on noncausality. It was argued that noncausality has a strong connection with a notion of temporal nonlocality. In the same way that Bell nonlocality is given different underlying explanations depending on the details of the chosen quantum mechanics' account, noncausality pointing towards temporal nonlocality can be given a variety of underlying descriptions depending on the exact way to interpret the process matrix formalism.The last chapter focused precisely on this particular point, namely on the various ways to understand process matrices and causal nonseparability in a realist context. In order to explore the potential impact of causal nonseparability on spacetime,we shifted from the notion of (indefinite) causal structure to (indefinite) spatiotemporal ones. This shift was allowed under a set of reasonable assumptions regarding the properties of a physical spacetime manifold and the connection between an operational and relativistic notions of causal relations.While different readings were suggested for indefiniteness of spatiotemporal relations, we insisted in particular on an objective understanding appealing to the concept of metaphysical indeterminacy. It was argued that such an approach could prove useful in a more general theoretical context such as quantum gravity, while being already partly supported in standard quantum mechanics.
La photométrie est la science qui s’'intéresse à la mesure de la lumière, à l’'intensité, l’'éclat, la brillance des sources lumineuses. Ses principes et ses méthodes ont été définis au XVIIIe siècle, en partie par Pierre Bouguer (1698-1758), dans son Essai d’'optique sur la gradation de la lumière, publié en 1729. Pourtant, un siècle plus tard, en 1833, François Arago (1786-1853) évoque, devant ses confrères académiciens, une science « restée à peu près stationnaire », à côté « des progrès brillants et inespérés » de l’'optique. Mêmement, en 1894, dans la revue La Lumière électrique, André Blondel (1863-1938), un jeune ingénieur employé au Service des phares et balises, se plaint du « peu de développement théorique » d’'une science qui « a conservé sans grand changement la phraséologie qu’'elle a reçue du XVIIIe siècle ». Il s’'agit ici de questionner la langueur supposée de la photométrie pendant tout le XIXe siècle. Le dépouillement des abondantes sources imprimées (revues scientifiques, professionnelles et une presse de vulgarisation en pleine expansion) a mis en lumière les travaux des photométreurs du XIXe siècle et leur implication dans l’'industrie de l’'éclairage, avec l’'appui des pouvoirs publics. Cette recherche livre aussi une analyse inédite des travaux de savants méconnus : ceux d’'Antoine-Philibert Masson sur la photométrie de l’'étincelle électrique et ceux réalisés à Marseille de 1879 à 1884 par Jules Macé de Lépinay et William Nicati sur la photométrie des sources colorées. Ces études où les effets physiologiques propres à la vision le disputent aux phénomènes physiques ont permis d’'affirmer la place de la photométrie entre la métrologie physique et la métrologie sensorielle. Enfin, les recommandations sur l’'unité de lumière, formulées lors des congrès internationaux des électriciens qui s’'échelonneront de 1881 à 1900 ont été examinées ainsi que la présomption contre l’'étalon Violle.
Dans cette thèse, nous donnons un éclairage épistémologique sur la première phase de l'astronomie arabe (IXe-- XIe s.) en étudiant deux questions. Qu'en est-il de l'influence du Livre des Hypothèses de Ptolémée sur les textes d'astronomie théorique ? Peut-on distinguer plusieurs traditions conceptuelles durant cette période ? Ceci nous conduit à une réévaluation du Livre des Hypothèses rendue nécessaire par la redécouverte en 1967 de la partie (I.2). Ptolémée y établit l'arrangement des astres errants, laissé en suspens dans l'Almageste, en mobilisant le principe des sphères emboîtées et le calcul de leurs distances à la Terre. Ce thème spécifique au Livre des Hypothèses est ici choisi en vue de répondre à nos questions. Nous avons ainsi délimité un corpus thématique de textes arabes dans lesquels les auteurs traitent des dimensions célestes. L'étude de ces textes nous permet de déterminer dans quelle mesure leurs auteurs s'appuient sur le Livre des Hypothèses. Dans le but d'identifier des traditions conceptuelles, nous analysons ensuite les différences de justification produites par les auteurs. Notre thèse se conclut sur l'édition et la traduction française de la clé de voûte de notre corpus : le chapitre X.6 d'al-Qanun al-Mas`udi d'al-Biruni. En effet, al-Biruni y analyse à la fois les méthodes et résultats de textes sanskrits et arabes, et ceux du Livre des Hypothèses.
Au XIX e siècle, l’impuissance sexuelle est une cause de nullité de mariage en Espagne. Ce travail repose sur sur l’analyse de 61 d’entre elles instruites par les tribunaux diocésains de Madrid et Saragosse entre 1777 et 1919 et d’un corpus de sources médicales, juridiques, littéraires et érotiques. À la fin du XVIII e siècle, l’impuissance est définie comme toute incapacité physique ou morale empêchant de pratiquer le coït, et peut donc concerner des femmes. Son traitement juridique et médical traduit la volonté de l’Église d’encourager la procréation et d’éviter les pratiques sexuelles immorales. À partir des années 1840, les savoirs sur la sexualité reproductive se transforment considérablement, donnant naissance à la fin du siècle à une « proto-sexologie » qui bouleverse les savoirs sur l’impuissance. Alors qu’au début du siècle ni le mot ni le concept de sexualité n’existent, à la fin du siècle ces nouveaux savoirs, l’approfondissement de la binarité de genre et l’émergence de la notion d’identité sexuelle en font une pathologie masculine interprétée comme le signe d’une virilité défaillante. Autour d’elle se concentrent alors des angoisses consécutives au « Désastre » de 1898 : celles d’une décadence et d’une dégénérescence de l’Espagne autrefois si puissante, qui aurait perdu sa virilité avec l’entrée dans la modernité.
Cette étude, basée sur des enquêtes sociolinguistiques menées auprès des Kurdes des quatre pays constituant le Grand Kurdistan (Turquie, Iran, Irak et Syrie), tend à exposer la complexité de la situation actuelle des communautés linguistiques kurdes. Elle cherche également à comprendre les aspirations des Kurdes par rapport à leur langue. Un ensemble de phénomènes sociolinguistiques sont observés et analysés, tels que : les compétences et pratiques linguistiques, les statuts et fonctions des langues, les attitudes et représentations sociolinguistiques, l’insécurité linguistique, la loyauté linguistique. Différents types d’analyses ont été utilisés : quantitative, qualitative et comparative. L’objectif est de fournir une vision plus claire de la situation sociolinguistique de la langue kurde dans chaque communauté kurde mais aussi pour l’ensemble des quatre communautés kurdes du Grand Kurdistan.
Les fêtes-sd d’Amenhotep III (XIVe s. av. J.-C.) rassemblent de nos jours, la documentation la plus riche autour de ces festivités particulières de l’Égypte ancienne. Trois célébrations sont attestées au cours de la dernière décennie de son règne, en lien avec l’anniversaire de son couronnement : la première, au passage de l’an 29 à 30, la deuxième à l’an 33-34 et la dernière à l’an 37-38. Elles semblent également toutes avoir été célébrées à Thèbes. La documentation réunie rassemble des étiquettes de jarres retrouvées sur le site palatial de Malqatta, érigé en vue des célébrations, mais également des figurations au sein de temples et de tombes, ainsi que des objets commémoratifs. Ces sources permettent de définir les lieux avérés et potentiels des célébrations, mais également le rôle et les charges particulières de certains dignitaires et membres de la famille royale. Le corpus rassemblant toutes ces attestations a permis de proposer des calendriers, certes partiels, mais offrant tout de même une vision du déroulé des cérémonies. L’étude des rituels exécutés montre une continuité des pratiques au sein de ces cérémonies depuis l’Ancien Empire, mais également que les fêtes-sd d’Amenhotep III ont influencé les roisaprès lui. Enfin, l’étude proposée est l’occasion de revenir sur les potentiels objectifs de ces célébrations afin de tenter d’en proposer une nouvelle signification.
L'apparition d'efflorescences cristallines sur des objets calcaires stockés dans des environnements pollués, communément appelée "dégradation de Byne", résulte de l'émission de composés organiques volatils (COV) acides par les matériaux de stockage. Ces acides réagissent avec le carbonate de calcium en formant des sels organiques de calcium, dont des acétates et des sels mixtes acétate-formiate, qui provoquent une détérioration irréversible du substrat. Jusqu'à présent, seuls des objets macroscopiques subissant la dégradation de Byne avaient été rapportés dans la littérature. Ce travail porte ainsi sur la manière dont la dégradation de Byne peut aussi affecter des spécimens calcaires microscopiques présents dans les collections de micropaléontologie. Il a été initié par la numérisation de la collection de foraminifères d'Alcide d'Orbigny (1802-1857), conservée au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), qui a révélé des dommages importants liés à la présence d’efflorescences salines. Un constat d’état a été mené sur l’ensemble de la collection d’Orbigny (plus de 3600 spécimens), mettant en évidence que les altérations, à la fois anciennes et évolutives, sont influencées par la cristallinité des tests et l’origine des lieux de prélèvement des foraminifères. Des collections voisines ont été examinées à titre comparatif et des recherches en archives ont été menées pour retracer l’histoire matérielle de la collection depuis son entrée au MNHN. Elles mettent en évidence de larges variations de température et des évènements historiques tels que la crue de la Seine de 1910, qui expliquerait les taux d’humidité particulièrement élevés à l'intérieur des tubes où sont conservés les foraminifères. Ces variations de température et d’humidité, combinées à la présence de matériaux émetteurs de COV introduits à la fin du XIXe siècle dans le montage des spécimens, sont à l’origine de la pollution acide et de la prolifération des sels. Parallèlement à cela, une procédure de vieillissement artificiel a été élaborée pour reproduire la dégradation de Byne sur des microspécimens sains. Les produits de dégradation formés sur les spécimens vieillis, ainsi que sur une sélection représentative de spécimens historiques, ont été analysés de manière non invasive et sans contact par spectroscopie micro-Raman et par diffraction des rayons X sur ligne synchrotron. Ces analyses ont mis en évidence des phases minéralogiques différentes de celles observées dans la littérature sur les collections macroscopiques. Ce sont ainsi des formiates de calcium et tout particulièrement le β-polymorphe du formate de calcium, connu pour être instable lorsqu'il est synthétisé en laboratoire, qui prédominent. Aucun acétate ou sel mixte de calcium n’a pu être identifié sur les foraminifères d’Orbigny. Les vieillissements montrent que l’humidité relative et la taille des spécimens jouent un rôle primordial dans la formation des sels : des conditions humides favorisent la cristallisation du formiate de calcium sur le spécimen, tandis que l'acétate, très hygroscopique, est sujet aux cycles de déliquescence-cristallisation qui le conduisent à se disperser autour de l’échantillon lorsque celui-ci est tout petit. Enfin, pour mieux comprendre la prédominance du β-polymorphe du formate de calcium, différentes solutions de formiate de calcium ont été laissées à évaporer et placées dans des environnements à humidité variée afin d’étudier la transformation βα. L’analyse semi-quantitative des produits montre que la présence d'ions étrangers tels que ceux présents dans les coquilles de foraminifères (Mg2+, Sr2+...) favorise l’émergence du β-polymorphe, et ralentit sa transition vers la phase stable. Ce travail montre que la nature des sels formés par la dégradation de Byne n’est pas seulement tributaire des COV présents mais dépend aussi de la taille des spécimens, leur composition, la cristallisation de leur test et des cycles d’humidité et de température auxquels ils ont été soumis.
Upon his death in 1704, the Minim friar, botanist to Louis XIV, and intrepid traveler Charles Plumier (1646-1704) left in his Parisian convent a mass of drawings on the flora and fauna of the West Indies. The industrious Plumier was a naturalist with inky fingers: his firsthand observations on the Caribbean islands translated into thousands of paper materials extremely heterogeneous in form and content. They encompass exquisite inkand- watercolor pictures and rapidly executed sketches, rough notes and elaborate written descriptions, detailed measurements and interminable lists. For all their diversity, Plumier’s papers bear the common desire to depict, describe, and inventory flowery and non-flowery plants, seeds and leaves, fishes and shells, reptiles and birds—in one word, to capture a faraway nature on paper. “Nature in Draft” mines this exciting and virtually untapped 8,000-page archive, and traces its history from the field, through the often tortuous paths that brought part of it into print, down to its eighteenth- and nineteenth-century afterlives. By paying particular attention to the materiality of Plumier’s corpus and the practices by which it was crafted and subsequently put to use, my aim is to relocate the much-debated notion of “scientific image” within a broader perspective on the working methods and intellectual technologies that underpinned the production and transmission of natural knowledge in France around 1700. Each of the six chapters foregrounds a different aspect of Plumier’s papers. The first two chapters consider the intellectual and political dimensions of the corpus; the third and fourth move towards an in-depth analysis of the archive as a tool for the recording, storing, and management of natural historical information; the last part of the dissertation deals with the transmission and reception of the collection, both in print and through the appropriations and relocations of which it was the object long after the death of the author.
Outre l'analyse de l'implication des lions et des bovins dans les croyances des populations syriennes de l'âge du Bronze (IIIe-IIe millénaire av. J. -C. ) et, par extension, du rapport entretenu par les dites populations avec le monde sauvage et le monde domestique, cette étude présente un double objectif : 1. mettre en oeuvre une méthode quantitative objective des représentations animales afin que la diffusion du travail permette à terme de valider ou d'invalider la méthode 2. reprendre l'étude du concept de croyance afin d'envisager ce dernier sous un angle nouveau, considérant la croyance comme relevant d'une idéologie, ce qui implique que la croyance puisse être tout aussi bien d'ordre religieux que politique. Pour répondre aux problématiques du sujet, l'étude commence par une présentation des fondements de l'analyse, ce qui permet de cadrer les conditions spatiales, temporelles et conceptuelles de celle-ci. L'approche en a été pluridisciplinaire, mettant en oeuvre la psychologie, l'histoire des religions, la zoologie, l'ethnographie, l'archéozoologie et la philologie. Après l'établissement des critères zoologiques et éthologiques permettant de discriminer, au sein du règne animal et à l'intérieur de chaque famille concernée (félidés et bovidés), le lion et les bovins, les informations archéozoologiques permettent d'affiner les critères d'identification des représentations. Le matériel archéologique (ossements et iconographie) est alors passé au crible des critères susmentionnés permettant ainsi d'établir le corpus des données, les données ethnographiques et textuelles complétant l'analyse.
The purpose of this study of three municipal museums of natural history in Nantes, Lyon and Toulouse, from ca. 1800 to 1870, is to offer a history of museums which values the situational configurations, whether social, spatial, and also environmental. Rooted in a social history of scientific practices, this enquiry reveals the plurality and the contextual plasticity of natural history museums. The soaring of collecting activities in the nineteenth century and the accumulation of collection objects may have been enough to explain the changing figure of museums. But the many transfers of collections to news locales or to the owning hands of the municipality, as well as failed projects, cast light on museums which were constantly re-composed when not de-composing. The unstable nature of the nineteenth-century municipal museum of natural history certainly contrasts with representations of immutable science inscribed in neutralised places. This is not the history of a proto-museum of natural history which eventually came into final form after 1870. Rather, the focus is set on a particular moment of their longer history which seeks to highlight their fluidity, unfinishedness and peculiarities in contrast with narratives of model institutions and perfection. Through this lens of the everyday, the dissertation shows how the history of the construction of the geographical and social spaces of the museums resulted from the gaining, maintaining, and fitting it into the space of the city. Far from being a container of objects and knowledge cut off from the society, practices of natural history at the museum and the construction of natural knowledge as capital also entailed field practice and interactions with manifold actors, naturalists and non. The museum, consequently, emerged as a place of knowledge which extended well beyond the museum building. By decentring the gaze and considering the provincial space from there rather than with incomparable centres, the dissertation examines the modalities of the local construction of scientific authority and how it was manoeuvred through the scientific and administrative hierarchies. Observation of the keeping of natural knowledge and objects at municipal museums of natural history shows how local norms and frames of reference were produced which neighboured and made us of, rather than neglected, universal scales of scientific knowledge, and illuminates the changing contours of natural knowledge in relation to place.
|