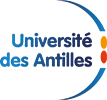Victoire ou la saveur des mots créoles
Résumé
Maryse Condé, qui prend une sévère distance avec les tenants de la créolité dont elle récuse les principes d’une opposition artifielle entre « langue maternelle [..], créole » et « français, langue de colonisation », accompagne souvent d’un emploi de « notes explicatives et autres glossaires » les mots en créole, qu’elle intègre sans aspérité dans le moule du français pour en neutraliser tout exotisme. Les occurrences en créole privées de ce surplus explicatif, de fait plus rares dans la production littéraire condéenne, piquent d’autant la curiosité du lecteur qu’elles suscitent la recherche d’une interprétation. Contrairement à la plupart des travaux de la critique condéenne, cette communication ne se consacrera ni à l’instauration d’une figure d’auteur au gré du maniement des deux langues, ni à la présence des créolismes émaillant son oeuvre, mais à l’ensemble des mots, dont le recours à l’italique et aux guillemets signale clairement l’appartenance au créole. Dans le récit de Victoire, les saveurs et les mots 2006, trois modalités d’insertion apparaissent, dont l’ordre figure l’investissement progressif du lecteur qui l’interprète : la traduction, retirant tout ambiguïté au sens du mot, la présence d’un cotexte fournissant les notions nécessaires à sa compréhension, enfin l’absence totale d’éléments connexes susceptibles de l’élucider. C’est ce rapport à la nécessaire négociation du sens par le lecteur qui est interrogée ici. Dans quelle mesure ce jeu de clair-obscur, évoluant entre transparence et opacité sémantique, participe-t-il à la construction d’une posture particulière de lecteur ? En quoi la connaissance du réel antillais, tantôt clairement fournie par un auteur soucieux de la compréhension de son lecteur, tantôt soustraite à un lecteur démuni, s’avère-t-elle nécessaire pour parcourir un récit profondément ancré dans une réalité guadeloupéenne historiquement et culturellement clairement identifiée ?
Après avoir exposé la façon dont français et créole se répondent en clair-obscur dans le chapitre liminaire, nous recenserons les emplois du créole dans les chapitres 1 à 5, avant de discuter la signification de certains passages, dont l’obscurité a moins partie liée à la compréhension de la langue qu’aux références culturelles qui lui sont attachées.